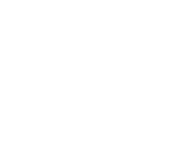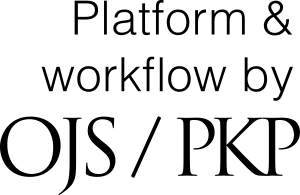«Les examens des recrues sont des leviers du progrès du système scolaire !» PISA au 19ème siècle : les examens des recrues. Intentions et effets.
DOI :
https://doi.org/10.24452/sjer.29.1.4763Mots-clés :
Epreuves des recrues, évaluation des systèmes éducatifs, niveau sco- laire de la population masculine, éducation au 19eRésumé
L’implémentation des standards de compétences scolaires dans le cadre du système scolaire en Suisse n’est pas un effet de mode; ces dispositifs de mesure y possèdent en effet une tradition solide. Au cours du 19e siècle, un accroissement du niveau d’instruction de la population masculine s’est produit dans chaque canton, ce qui a entraîné une évaluation des effets du système éducatif. En 1832, le canton de Soleure introduit les «examens pédagogiques des recrues» qui, initialement, font office d’instruments indicatifs utilisés à des fins militaires. Vers la fin du 19 e, malgré la résistance acharnée des cantons, ces tests sont généralisés au niveau suisse sous l’égide de la Confédération. Ainsi, celle-ci intervient directement dans la question des écoles élémentaires, qui à l’époque se plient à la souveraineté cantonale. Mais, selon la constitution, la Confédération a le droit de sanctionner les cantons qui n’offrent pas un enseignement élémentaire satisfaisant. Plus tard, à l’appui de nombreux relevés des statistiques, un concours scolaire fédéral a été ouvert dans le but de réformer la politique éducative et d’uniformiser les systèmes scolaires cantonaux. Pourtant, en raison des importantes divergences régionales, le succès de ces tentatives d’harmonisation n’a été que partiel.
Téléchargements
Téléchargements
Publié
Numéro
Rubrique
Licence

Ce travail est disponible sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International .